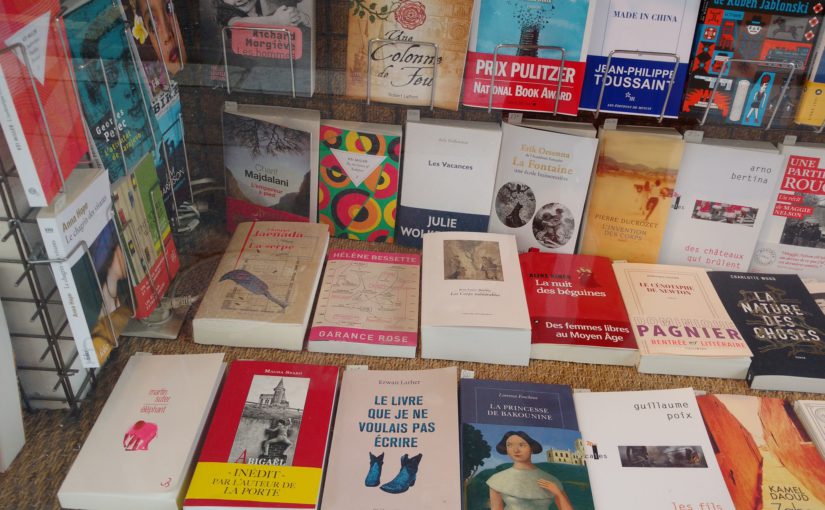Extrait de La Pensée en fiction, de Cédric Jullion
Rose de Garance est forcée de prendre sa retraite anticipée à la suite d’une lettre de diffamation adressée par une trentaine de personnes de son village à l’inspection académique de son département. Jetée sur le marché de l’emploi, elle tente de retrouver une place dans une entreprise, mais se résigne à réintégrer l’éducation nationale en faisant valoir ses droits. De retour dans un milieu qui ne la désirait déjà pas beaucoup, tous les coups sont permis pour empêcher Rose d’aboutir.
Le nom du personnage est déjà rapidement déstabilisé. Un problème à plusieurs inconnus, un « de » en trop, provoque l’inégalité des facteurs, « c’est-à-dire le drame ». Rose appartient à un aristocratie dont elle a quitté la noblesse en devenant institutrice, métier jugé fantaisiste par la famille qui assimile la « parente aux mille enfants » à une cover girl, une chanteuse, une starlette, un mannequin ou une strip-teaseuse. Elle est devenue une sorte de cousine pauvre dans un milieu où il se dit en catimini qu’on aurait préféré une femme sans enfants, ou tout au plus, avoir à s’occuper d’enfants sans pères plutôt que d’avoir à vivre à proximité d’une institutrice. Qu’elle ne compte pas sur l’héritage qui sera promis aux « p’tits de Garance » qui, eux, ont un avenir plein de promesses. « Des propriétés leur sont destinées », mais ces fortunes, pour le moment « non réelles », leur mère n’en profitera pas. Comme une sorte de victime désignée, elle devra, avec ses propres moyens, « subir la chance du voisin », et n’être que le « spectateur du bonheur de l’autre ». Malgré ces marques de mépris, Rose occupe son « humble position » avec dignité. Dès le début, un déséquilibre met en mouvement le roman qui soulève, selon l’auteur fictif, le « mince théorème des Révolutions éternelles » : l’injustice du sort et des naissances.
Les personnages qui entourent Rose ne portent pas de nom et sont désignés par leur fonction sociale ou administrative. Au niveau de sa vie privée agissent le maire, le curé, l’infirmier, le garde champêtre, la postière, une femme de ménage, mais aussi « le boucher le boulanger le facteur le pâtissier le charcutier le commis boucher le commis menuisier ». Dans son milieu professionnel se trouvent hiérarchiquement placés l’Inspecteur d’Académie, « Petit Jupiter de Province », l’inspecteur primaire, la Directrice d’école et son adjointe, les institutrices, puis le patron, la Directrice des services, les secrétaires et les collègues. À l’intérieur du village, la classe sociale populaire alimente une rumeur qui prend naissance au confessionnal et se nourrit au café du Commerce et de l’Industrie, fréquenté presque uniquement pour aller y chercher quelque information. Ainsi, du constat que Rose n’est pas sympathique, qu’elle est sale, alcoolique, qu’elle se drogue, on commence à formuler des suppositions concernant une drôle de bronchite mal soignée (assimilée à un avortement masqué) et l’argent qu’elle possède. Décidant que quelque chose de pas clair suffit à agir de concert, on lui fait comprendre que des femmes comme ça, on n’en veut pas pour occuper la place d’une institutrice, on ne lui ramasse plus ses ordures, on la promet au matelassier et au cultivateur, et on s’autorise à prendre les décisions à la place de cette déraisonnée pour éviter qu’elle ne mette fin à ses jours. Rose devient une « ordure laissée pour compte », un « épouvantail informe et grossier ». Devant une série de détails sortant quelque peu de la normalité admise (elle est seule, elle reçoit des lettres de l’étranger, elle voyage fréquemment à Paris), la peur soude la masse populaire dont les décisions sont légitimées, comme le résultat d’une nature sociale, par un vote sanction. Un marquis, à l’origine de la cabale lancée contre l’institutrice, apporte une sorte de caution à cette loi sociale et assure au village tout entier une forme de fierté.
Le milieu professionnel de Rose est, lui, tout entier fondé sur les rapports hiérarchiques constituant la loi du travail. Scrupuleusement observé lorsqu’il s’agit d’assurer la stabilité de son rang, le respect de la hiérarchie est constamment rappelé au personnage. La sève de cette structure administrative est un flux continu d’influences où s’illustre un véritable instinct de survie. Les femmes, pour progresser dans leur carrière ou pour garder leur place, doivent faire preuve de séduction en mettant en avant leurs atouts. La jalousie est alors le moteur d’une vengeance féroce. L’hypocrisie, qui se lit sur tous les visages par un récurrent sourire « tu me dégoûtes », crée des personnages à part entière : l’homme-au-sourire, la Directrice-au-sourire. Le tout s’accompagne d’un tissu de connaissances, à la fois amicales et familiales, qui unit Rose à son propre pays, révélant que la loi en vigueur n’est pas forcément celle que nous croyons.
Au bout du fil : l’Académie la Préfecture l’ex-député le prochain ministre le général en retraite le polytechnicien de l’endroit le neveu d’un avocat célèbre (le barreau représenté). Sans oublier la gendarmerie. Qui a entendu parler de l’affaire en privé. Mais qui pourrait devenir publique.
Ainsi que le conseiller.
Et les valets de chambre du petit journal de la région.
(…)
Le procureur est reçu le dimanche chez la personne qui vous en veut. Et le grand-père de votre pire ennemi est député maire de la ville voisine.
(…)
Sans oublier que la nièce du Président de la République est la sœur de la Directrice du Service et que son mari connaît intimement le médecin de Madame de Garance.
(…)
Si le père du Chef du Cabinet est lié avec la belle-sœur du président de la République.
Lequel connaît le Procureur de ce suprême tribunal.
Et peut-être aussi marié secrètement à la sœur d’un ex-ministre mort pour la France.
Et glorieusement.
L’officiel et la légalité n’ont plus cours.
Si l’humour avec lequel Hélène Bessette traite ces liens révèle une caricature politico-sociale difficile à mémoriser, la récurrence de l’effet conduit adroitement à l’enchaînement du personnage et à l’édification de lois du non-dit. C’est, au village, la loi du plus grand nombre et, dans le reste de la société, la loi du plus fort. Hélène Bessette met en confrontation deux notions : l’Officiel et l’Officieux. En suivant la voie officielle, les lettres disparaissent, les dossiers se perdent, la mémoire n’agit plus, l’action du personnage est envisageable, mais elle n’aboutit qu’à l’obtention de promesses non tenues. En suivant la voie officieuse, la diffamation produit un effet ravageur, la mémoire s’alimente et se conserve, l’action des personnages qui la suivent aboutit. Un renversement de logiques s’est produit. Toutes les personnes ayant accueilli Rose avec bienveillance ont mystérieusement été remplacées. Le personnage « bienveillant et républicain », « égal fraternel et libre », n’appartient que « incidemment » au roman. La devise française est un prétexte pour mettre au monde un monstre épouvantable aux frontières de la déshumanisation, un tissu de confréries et de corporations où les « pourritures capitalo-républicaines » constituent le « plus grand Réseau du Monde ». Cette espèce de « totalitarisme d’opérette », fondé sur la dénonciation, est un moyen-âge obscur, conduisant un « troupeau concentrationnaire » à subir un « relent de nazisme à bon marché ». Si l’aspect fascisant fait naître une nouvelle doctrine, c’est bien l’idéal républicain qui est interrogé. La Directrice, « l’ancienne, évanouie au ciel menaçant de la République en douleur », emporte avec elle « cette espèce de lueur aperçue à l’aurore du socialisme ». L’égalité des chances, sur un air de misogynie radicale, n’est plus possible : « La ténacité du mal organisé donne la clef du problème : le sexe / Le sexe de Madame de Garance ». La liberté de vivre dans son droit n’a plus cours.
La justice officieuse remplaçant peu à peu la justice officielle est une victoire de l’oral sur l’écrit. Les paroles, les rumeurs et les arrangements ont plus de crédit que les lois et les rapports d’inspection. Avec les preuves et les personnages qui disparaissent, ce qui devrait être la continuité d’une vie modeste n’est plus que douleurs et souffrances. « Et trois ans plus tard le mal est tout aussi violent ».
Ces mouvements invisibles. Les éclatements lointains. Le grignotement des couleurs en course. Grinçant. Grinchant. Mille voix mêlées de douleurs. Douleurs sourdes impalpables volantes bruissantes.
Chansons fragiles diminuées éloignées
Voix grêles évanouies.
Dans la cire du souvenir trace indélébile.
La vie de Rose n’est pas véritablement la sienne puisqu’elle subit les conséquences d’un système social gangréné qui la condamne à n’être que la créature d’un groupe dans lequel personne n’a réellement pitié d’elle. Au cœur de ce système se joue la liberté d’agir et la liberté d’être. Le personnage n’est pas libre. Il est dans un milieu carcéral.